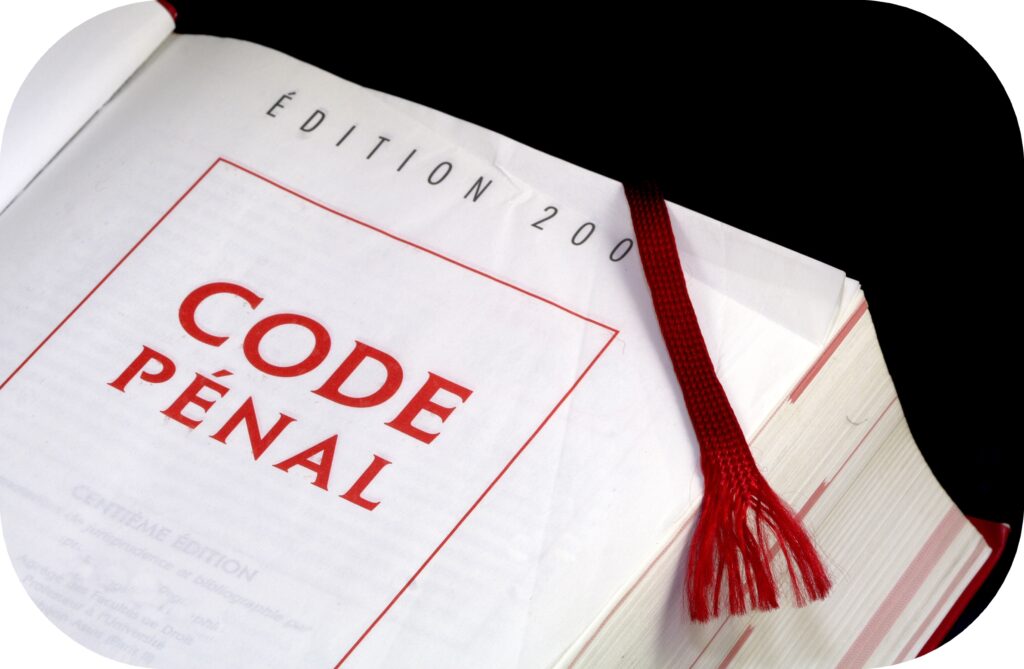contrefaçon de marque compétence du tribunal de grande instance
Marques et noms de domaine Contrefaçon Compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de contrefaçon Toutes les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles et de marques, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2009 (1), en apportant une précision utile sur la compétence territoriale des tribunaux. Saisi d’une affaire relative à des faits de contrefaçon commis à Paris et opposant deux sociétés ayant leur siège social en ce même lieu, le Tribunal de commerce de Paris s’était déclaré compétent. Non satisfaite de cette décision, la défenderesse a formé un contredit devant la Cour d’appel de Paris et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. Les juges de la cour d’appel ont examiné la question, non seulement au regard des dispositions de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 (2) et de l’article 135 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (3), mais également en vertu des règles de compétence territoriale du Code de procédure civile. Ils ont décidé que « depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la publication au journal officiel de la première de ces deux lois, les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L331-1, L521-3-1 et 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié, dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ». Rappelons que, selon les lois précitées, les actions en contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modèles industriels et de marques, qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsque les actions et les demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique/de dessins et modèles industriels ou de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. Elles prévoient, également, que les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions et demandes doivent être désignés par voie réglementaire. A ce jour, aucun décret n’a été publié en ce sens. La décision de la Cour d’appel de Paris vient pallier l’incertitude inhérente à ce défaut de publication. Sauf revirement de jurisprudence, il est désormais acquis que chaque tribunal de grande instance est compétent territorialement, selon les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, pour toutes les actions et demandes en matière de contrefaçon précitées. (1) CA Paris 11 février 2009 (2) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ; (3) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque (Mise en ligne Mai 2008) Contrefaçon par imitation : quels critères ? (Mise en ligne Décembre 2007) La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques (Mise en ligne Décembre 2007) Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées (Mise en ligne Octobre 2007) Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque (Mise en ligne Juillet-Août 2007) La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon… (Mise en ligne Juillet 2007) L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant (Mise en ligne Avril 2007) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon (Mise en ligne Février 2007)