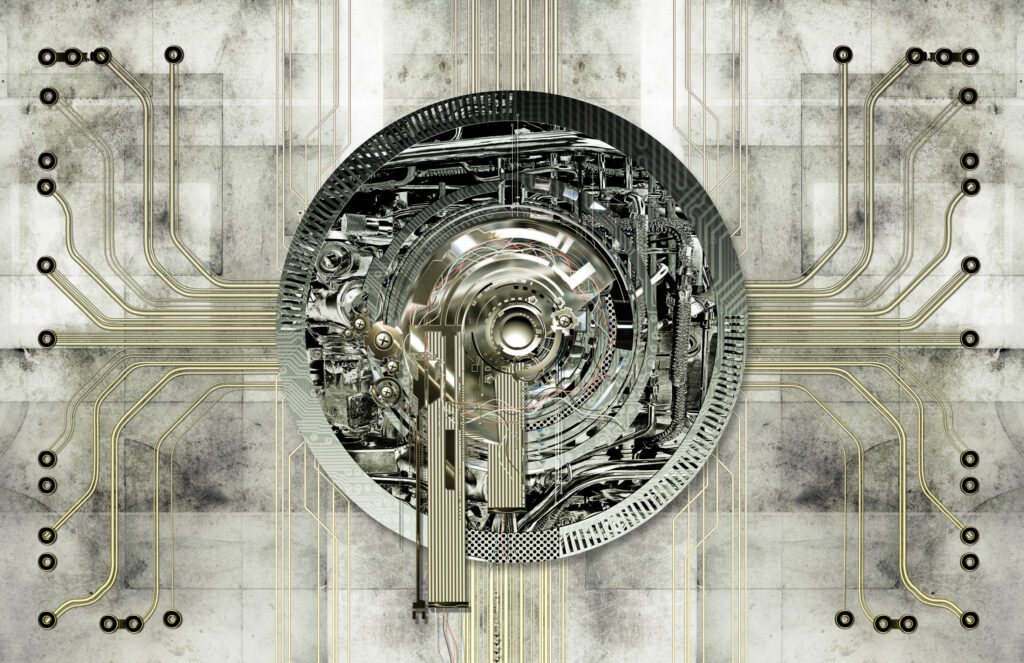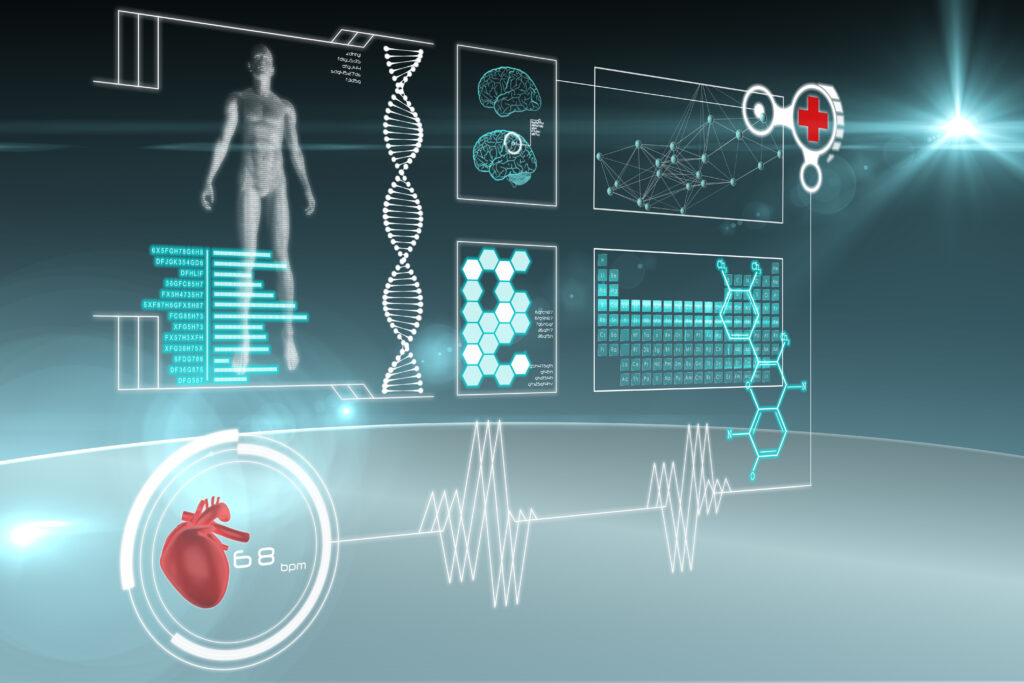Après le développement d’univers fantasmagoriques par le jeu vidéo dans les années 1990, la réalité virtuelle offre aujourd’hui une nouvelle possibilité d’accès au monde virtuel. Cette fusion entre deux états, le réel et le virtuel, qui permet la sensation du réel dans un univers virtuel, ou encore virtualité, crée un troisième état de réalité virtuelle, dont le caractère protéiforme rend la protection par le droit d’auteur complexe. Les applications de réalité virtuelle sont un patrimoine intellectuel protégeable par le droit d’auteur qui protège les « œuvres de l’esprit » originales quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (1). L’application de réalité virtuelle qui réunit et intègre des composants multiples s’apparente à une œuvre multimédia dont le régime juridique doit lui être transposé par analogie (2). En tant qu’œuvre multimédia et l’instar des jeux vidéo, les applications de réalité virtuelle doivent être appréhendées comme des œuvres complexes. L’œuvre complexe, notion introduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2009 (3), est celle au sein de laquelle sont incorporées diverses composantes. Le caractère protéiforme de l’œuvre complexe impose que chaque élément se voit appliquer le régime juridique qui lui est propre en fonction de sa nature mais également de son caractère réel ou virtuel. Ainsi, devront être appréciées selon leur propre régime de protection des œuvres de nature différente, telles que des œuvres littéraires, musicales, graphiques, audiovisuelles, des logiciels, des bases de données. En effet, la partie virtuelle de l’application est constituée d’éléments protégeables par le droit d’auteur comme des écrits, dessins, graphiques, compositions musicales, etc. Ces éléments, par l’effet d’immersion et d’interaction, ont vocation à fusionner avec le réel, par exemple par exemple le parcours d’une exposition, une construction architecturale. Cette fusion par le biais de l’application de réalité virtuelle pourrait équivaloir à une reproduction et à une représentation de l’œuvre issue du monde réel. Compte-tenu de la qualification distributive applicable, chaque composant identifié se voit appliquer le régime qui lui est propre. D’une part, l’éditeur de l’application de réalité virtuelle doit bénéficier d’une cession des droits attachés à chaque élément intégré dans l’œuvre de réalité virtuelle, qu’ils aient été créés par des prestataires externes ou des salariés (sauf pour le logiciel, l’employeur bénéficie d’une dévolution légale des droits sur les développements de ses salariés). Ni le contrat de travail, ni le contrat de commande n’emportant dérogation à ce principe. D’autre part, si le réel entraîne la reproduction d’œuvres protégées (œuvres d’art, œuvres architecturales, etc.), l’éditeur doit obtenir des auteurs ou ayant-droit les droits lui permettant de reproduire, puis de diffuser ces œuvres. Comme un site internet, l’application de réalité virtuelle prise dans sa globalité pourrait également être protégée de façon unitaire, sous réserve d’obéir au critère impératif d’originalité, appréciée au regard de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’approche unitaire ne doit toutefois pas restreindre l’approche distributive qui doit demeurer la règle pour l’intégration dans l’œuvre de divers éléments protégés par le droit d’auteur. Marie Soulez Lexing Contentieux Propriété intellectuelle (1) CPI, art. L. 112-1. (2) « Informatique, Télécoms, Internet », Ed. Francis Lefebvre, 5e Ed., chapitre IV Multimedia. (3) Cass. 1e civ., 25-6-2009, n° 07-20387.