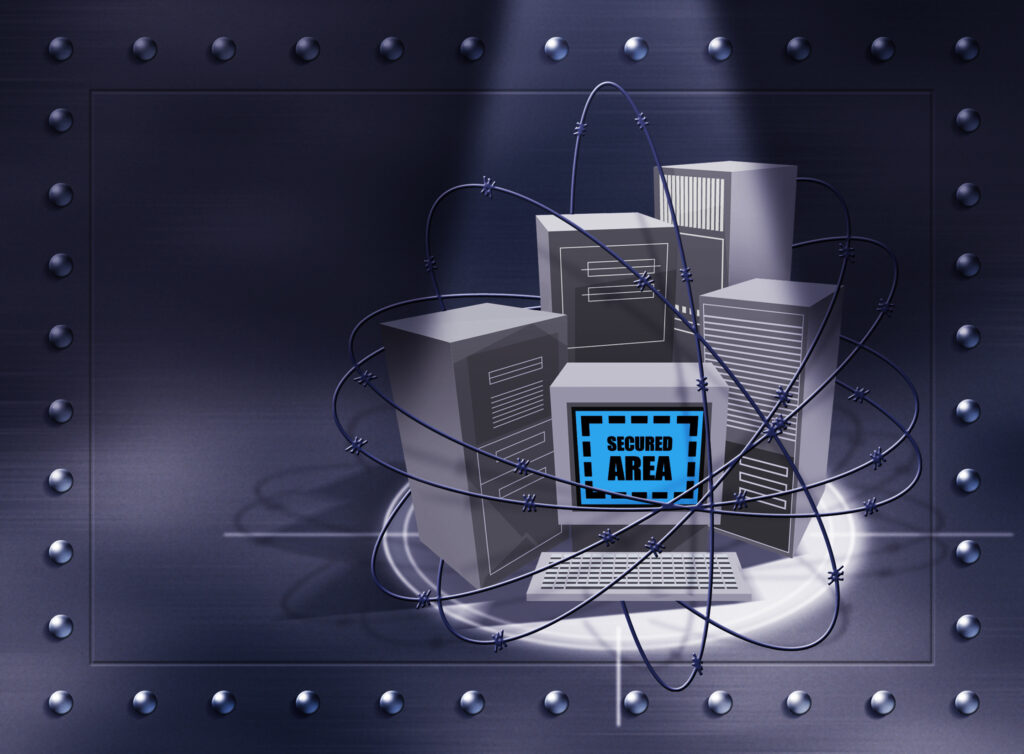Contentieux informatique Contrats internationaux Adoption du règlement » Rome I » sur les obligations contractuelles La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est remplacée par le règlement du 17 juin 2008 (dit » Rome I « ). Ce règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il concerne les contrats conclus après le 17 décembre 2009. A compter de cette date, il remplacera, entre les Etats membres, la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui détermine la loi applicable aux contrats internationaux. Il ne s’appliquera pas au Danemark et au Royaume-Uni à moins que ces Etats n’y adhèrent dans le futur. Ce nouveau texte affirme le principe selon lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties, et ce même si la loi qu’elles désignent n’a aucun lien avec le contrat, sous réserve d’une fraude à la loi et de l’application par le juge saisi des lois de police de son pays (article 3 du règlement). A défaut de choix de la loi applicable au contrat par les parties, le règlement précise quelle est la loi applicable (article 4 à 8 du règlement). Il s’agira de la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat. Il est présumé que cette loi est la loi de résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat, bien qu’il puisse y avoir des exceptions (contrat de travail notamment). S’agissant plus particulièrement des contrats de consommation, la loi applicable est celle du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans la cadre de cette activité. A cet égard, le règlement rappelle la déclaration conjointe du Conseil européen et de la Commission européenne relative à l’article 15 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui précise, à propos de la notion d’ « activité dirigée », que « le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site internet ne constitue pas un élément pertinent » (considérant 24 du règlement). Le règlement édicte également les règles obligatoires s’appliquant aux contrats internationaux (lois de police, consentement et validité au fond, validité formelle…). L’objectif poursuivi par ce texte est d’harmoniser les règles de conflit de lois relatifs à des obligations contractuelles relevant des matières civile et commerciale et ne concerne par conséquent pas les situations non contractuelles de droit privé qui font l’objet d’un règlement, adopté le 11 juillet 2007 (dit » Rome II « ). Règl. CE, n° 593/2006 du 17 juin 2008 , JOUE(L) 177 du 4 juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves ( )