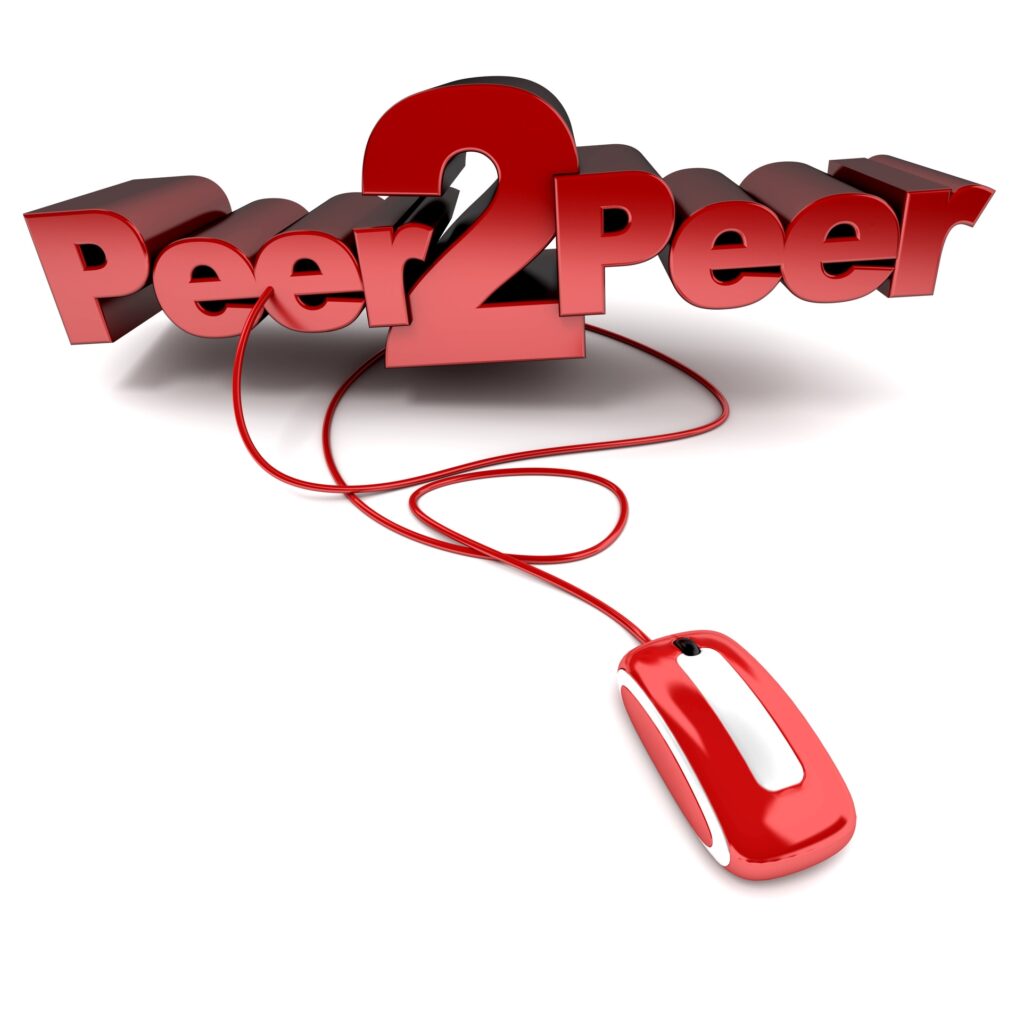Internet contentieux Contenus illicites Google Suggest et les blogs « anti-arnaque » : abus ou liberté d’expression ? Deux décisions contradictoires viennent d’être prononcées sur la question de la licéité de l’exploitation par Google de la fonction d’aide à la recherche baptisée « Google Suggest ». Cette fonction permet à l’internaute, qui tape les premières lettres ou les premiers mots de sa requête dans la barre de recherches Google, de se voir proposer plusieurs mots-clés qui y sont associés et qui correspondent à des résultats référencés par le moteur de recherches. Les suggestions de recherche sont établies sur la base de statistiques, qui recensent les mots-clés les plus fréquemment sélectionnés par les internautes. Des contentieux commencent à naître, en raison de l’association, via cette fonctionnalité, d’une entreprise, de sa marque ou de son nom de domaine avec un terme péjoratif, de type « arnaque », bien souvent situé parmi les premières suggestions proposées. Tel était le cas, dans les deux affaires portées respectivement devant le Tribunal de Commerce (« Direct Energie arnaque ») et le Tribunal de Grande instance de Paris (« CNFDI arnaque »). Dans son ordonnance de référé du 7 mai 2009, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, saisi sur le fondement du dénigrement (article 1382 du Code civil), a fait droit à la demande de la société Direct Energie considérant que celle-ci était associée, par l’emploi du terme « arnaque », à « un comportement pénalement répréhensible ». Selon l’ordonnance, une telle association jetait sur cette société, « une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux ». Le tribunal a ainsi estimé que la société Google Inc avait commis une faute en participant, même involontairement, à une campagne de dénigrement, à laquelle elle donnait ainsi un écho particulièrement important, considérant le nombre considérable d’internautes utilisant ses services, et ce, d’autant que le classement des suggestions ne présentait pas de caractère objectif. A l’inverse, dans la seconde affaire, le CNFDI, qui fondait son action sur l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 (injure publique), s’est vu débouter de l’ensemble de ses demandes. En effet, bien que le Président du Tribunal de Grande instance de Paris ait considéré que la suggestion de recherche litigieuse était susceptible de constituer une injure publique, il a relevé qu’une contestation sérieuse existait sur la question de l’intention coupable de la société Google. Au demeurant, le juge a estimé qu’une telle suggestion n’était pas illicite en elle-même. En effet, aux termes de son dispositif, les suggestions de recherches litigieuses, en permettant effectivement d’obtenir des résultats pertinents, contribuent à la libre circulation des informations sur le réseau. Aussi, le juge a-t-il décidé que, les interdire, « en cet état de référé, constituerait une restriction de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées qui excéderait, dans une société démocratique, les nécessités de la protection des droits d’autrui ». Dans l’attente d’une nouvelle affaire, ces deux décisions laissent les justiciables dans une désagréable incertitude juridique, s’agissant aussi bien du fondement de leur éventuelle action, que de l’issue prévisible de celle-ci. Rappelons toutefois que la prolifération de blogs associant des entreprises à des « arnaques », et dont le référencement « remonte » en première page grâce à la fonction « Google Suggest », est souvent le fait de quelques clients mécontents qui créent du « buzz » sur internet et savent bien utiliser le fonctionnement des moteurs de recherche. Le préjudice considérable qui peut en résulter pour les entreprises concernées ne semble bien souvent pas proportionné, au regard de la masse des clients satisfaits. TC Paris 7 mai 2009 TGI Paris 10 juillet 2009 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Notification hébergeur : preuve par tous moyens de la connaissance effective du caractère illicite des contenus (Mise en ligne Août 2009) Statut de l’agrégateur de flux RSS (Mise en ligne Juillet 2009) Une nouvelle décision relative aux contours de la responsabilité de l’hébergeur (Mise en ligne Avril 2009) Un nouveau critère de qualification de l’éditeur : la contribution à la création des contenus (Mise en ligne Mars 2009) Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs? (Mise en ligne Janvier 2009) Respect de la procédure de notification LCEN (Mise en ligne octobre 2008) Vidéos contrefaites : la responsabilité de l’hébergeur est retenue (Mise en ligne Avril 2008) Droit de réponse et identification du directeur de la publication (Mise en ligne Mars 2008) Responsabilité de Google en qualité d’hébergeur (Mise en ligne Février 2008)