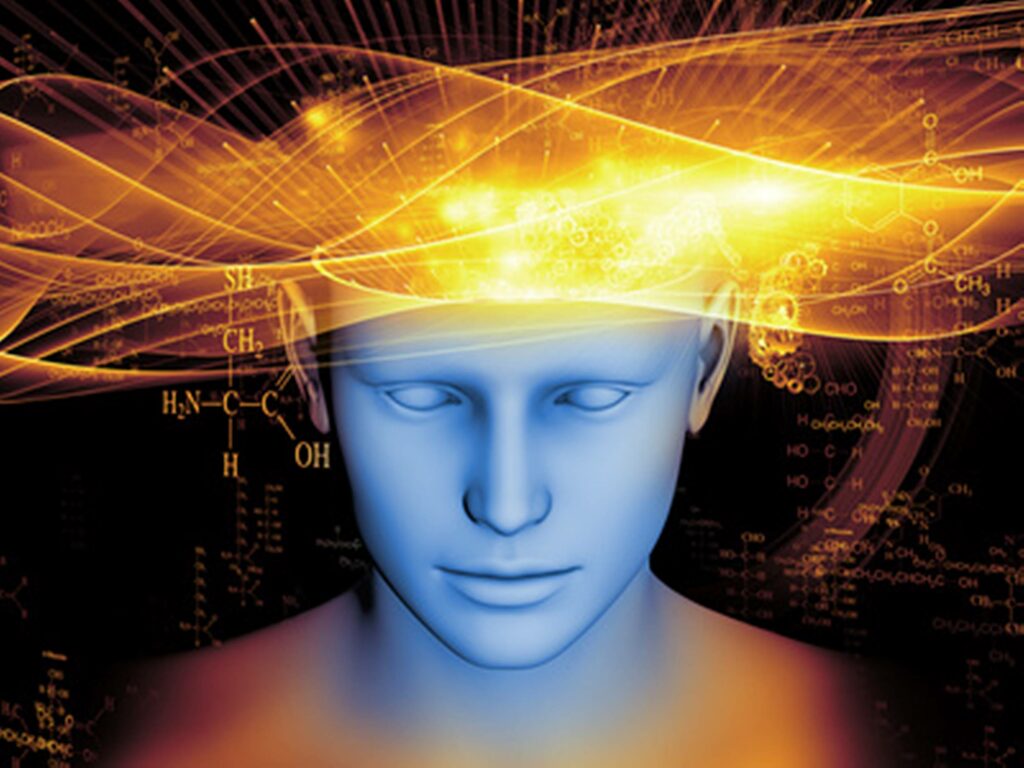lutte contre la cybercriminalité conseil de l’europe conclusions
Pénal numérique Cybercriminalité La lutte contre la cybercriminalité vue par le Conseil de l’Union Européenne Le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter, les 27 et 28 novembre, des conclusions relatives à la lutte contre la cybercrimnalité. Il rappelle, tout d’abord, l’importance d’envisager la cybercriminalité dans ses différents composants et invite les Etats membres et la Commission à définir une stratégie de travail concertée en prenant en compte la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Le Conseil précise qu’il s’agit de lutter contre l’ensemble des activités criminelles commises à l’aide des réseaux électroniques, tels que la pédopornographie, le terrorisme, la fraude à l’identité ou encore les infractions financières. Pour y parvenir, le Conseil de l’Union Européenne propose un certain nombre de mesures applicables à plus ou moins long terme. Sont ainsi envisagés la création d’une plate-forme européenne de signalement des faits de nature délictuelle, le recours à des équipes communes d’enquête et d’investigation ou encore la facilitation des perquisitions à distance, à condition, toutefois, que cela soit prévu par le droit national. Le Conseil souligne, enfin, qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre les autorités répressives et le secteur privé, notamment par l’échange de données opérationnelles et stratégiques afin de renforcer leur capacité d’identification et de lutte contre les nouvelles formes de cybercriminalité. Conseil de l’Europe, Conclusions sur la lutte contre la cybercriminalité, 27 et 28 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Un nouveau plan de lutte contre la cybercriminalité : la conservation des données de connexion étendue et les contrôles à distance renforcés (Mise en ligne Avril 2008)