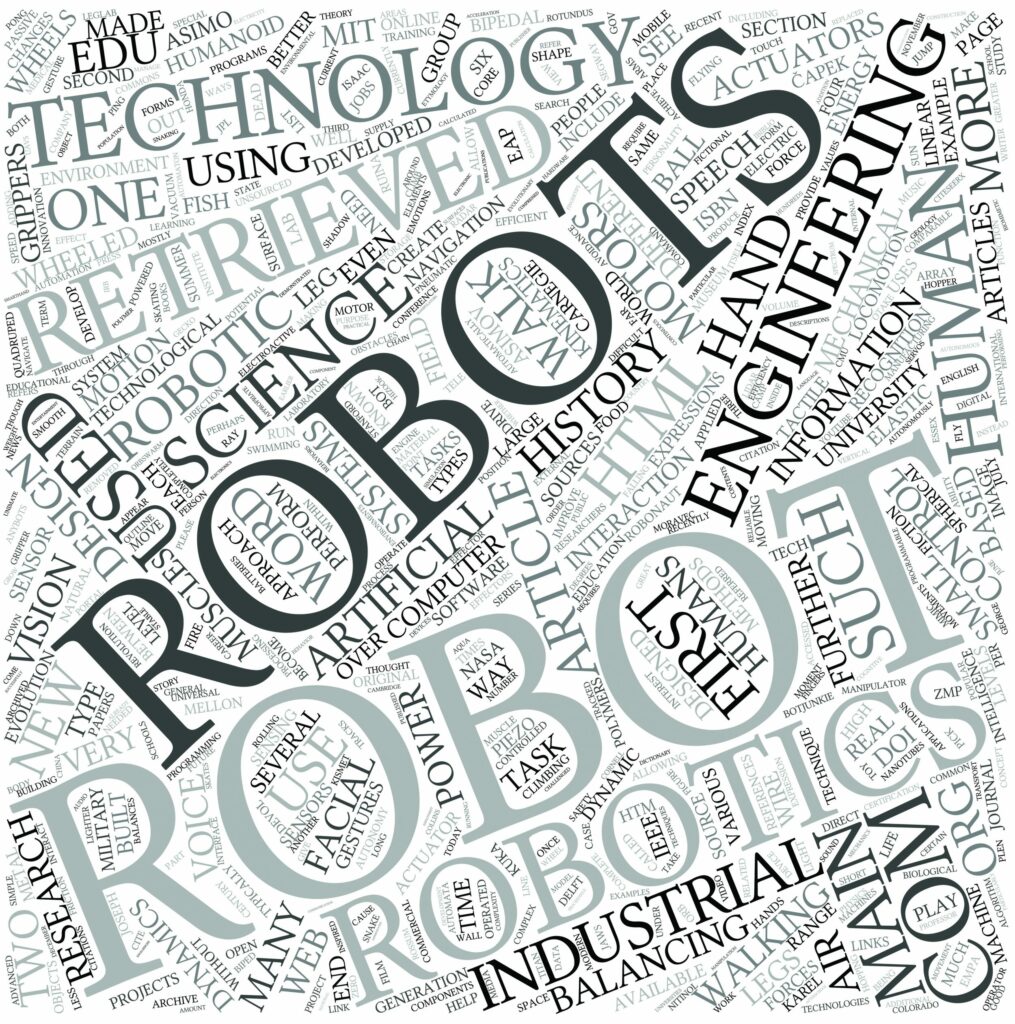Vol de données : modification de l’article 323-3 du Code pénal
La loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme opère, par son article 16, un changement de rédaction de l’article 323-3 du Code pénal, permettant de réprimer le vol de données, sans toutefois recourir à la qualification de vol. Institués par la loi dite « Godfrain », les articles 323-1 à 323-4 du Code pénal (1) prévoyaient cinq atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (bien connus sous l’appellation « STAD »), lesquelles sont : l’accès ou le maintien frauduleux dans le STAD ; l’action d’entraver ou de fausser le fonctionnement du STAD ; l’introduction frauduleuse de données dans un STAD ou la modification des données qu’il contient ; l’importation, la détention, l’offre, la cession ou la mise à disposition d’un équipement, d’un instrument, d’un programme informatique ou de toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions au STAD ; enfin, la participation à un groupement de pirates informatiques. Cette troisième atteinte a été modifiée en novembre dernier afin d’intégrer dans son champ de répression l’inquiétant et récurrent vol de données, qui y échappait jusqu’alors. L’ancien texte permettait, en effet, uniquement de condamner l’introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données dans un STAD… mais nullement leur copie. Pour combler ce vide juridique, plusieurs voies avaient été envisagées, parmi lesquelles la contrefaçon ou l’abus de confiance. La qualification de vol qui semblait correspondre au mieux à la copie de données avait été, quant à elle, écartée, tant il était considéré (sans doute à juste titre) qu’il n’y avait pas soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui (2) : absence de soustraction, d’une part, puisque le légitime propriétaire des données les conserve et n’en est à aucun moment dépossédé (sauf hypothèse du vol de disque dur) ; absence de chose à proprement parler, d’autre part, puisque la soustraction vise un bien matériel pouvant être saisi physiquement (là où les données sont des biens immatériels). Or, la loi pénale est d’interprétation stricte et la règle est d’or. Malgré les tentatives de la jurisprudence (3), la répression du « vol » de données se fait donc au détour de la qualification de vol (et de celle de recel), par l’ajout de quatre mots au texte de l’article 323-3 du Code pénal, en vigueur depuis le 15 novembre 2014, lequel réprime désormais, outre le fait d’introduire, de modifier et de supprimer, le fait « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre » frauduleusement des données dans un STAD. La loi du 13 novembre 2014 vient ainsi sanctionner la copie frauduleuse de données, dans une optique de protection accrue de « l’économie de la connaissance ». Virginie Bensoussan-Brulé Annabelle Divoy Lexing Droit pénal numérique (1) L. n°88-19 du 5-1-1988 relative à la fraude informatique, insérant les articles 323-1 à 323-4 dans le Code pénal, en son Livre II « Des crimes et des délits contre les biens », Titre II « Des autres atteintes aux biens ». (2) Comme l’exige l’article 311-1 du Code pénal, définissant l’infraction de vol. (3) Cass. crim. 4-3-2008 n°07-84.002 Jean-Paul X Sté Graphibus.